
Le silence derrière les volets fermés !
Chaque été, les scènes se répètent dans les EHPAD avec une régularité accablante. Dans les couloirs, la lumière est tamisée, les ventilateurs tournent lentement, et le silence règne. Ce silence n’est pas celui de la paix, mais celui de l’épuisement. Derrière les portes fermées, les soignants s’activent sans relâche, à bout de souffle. Les résidents, eux, attendent : une toilette, un verre d’eau, une présence.
Et pourtant, il ne s’agit pas ici de pointer du doigt les EHPAD. Ce ne sont pas eux les fautifs. Ce sont souvent les premiers à subir. Ils sont les maillons d’un système déjà déstabilisé, à qui l’on demande de tenir coûte que coûte. Alors quand l’été arrive, avec ses absences, ses chaleurs, son manque de remplaçants, le fragile équilibre vacille.
1- Une pénurie bien plus qu’estivale
Cela fait plus d’une décennie que les professionnels de terrain alertent sur le manque d’effectifs dans les EHPAD. L’été n’est pas le déclencheur, mais l’accélérateur d’une crise systémique. Congés bien mérités, arrêts maladie, difficultés de recrutement… Tout s’accumule. Et là où il faudrait renforcer les équipes pour faire face à la canicule, à la déshydratation, à l’aggravation des pathologies, on fonctionne à flux tendu.
Dans certaines structures, on parle de 30 % d’effectifs en moins. Les soignants restants tiennent debout par vocation, par sens du devoir, parfois même par amour. Mais à quel prix ?
Une détresse largement partagée
Derrière les chiffres et les constats, ce sont des milliers de voix qui, chaque été, expriment leur détresse dans l’ombre. Sur les forums professionnels, dans les groupes de discussion en ligne ou simplement autour de la machine à café, les soignants racontent tous la même chose : l’essoufflement, la peur de mal faire, le sentiment d’abandon.
Partout en France, des aides-soignants, infirmiers, agents de service hospitalier disent qu’ils travaillent à flux tendu, dans des conditions qu’ils n’auraient jamais imaginées tolérables. Certains enchaînent les semaines sans repos, d’autres font face à des services où les renforts n’arrivent jamais. Dans un tel contexte, ce ne sont pas les compétences qui manquent, mais les bras, les moyens, le temps humain.
Et les données confirment cette impression de terrain. Selon le baromètre FEHAP‑Nexem publié en 2023, 92 % des établissements du secteur personnes âgées déclaraient rencontrer des difficultés importantes de recrutement, avec un taux de postes vacants de 4,4 % soit environ 6 000 postes non pourvus. Par ailleurs, le taux d’absentéisme dans les établissements médico-sociaux atteint jusqu’à 16 % dans certaines régions, selon la CNSA, avec une moyenne nationale estimée entre 11 et 13 % en période estivale.
Cette pénurie chronique pèse aussi sur la vie sociale des résidents : une étude de 2023 conduite auprès de 850 établissements a révélé que 58 % des EHPAD ont dû suspendre ou réduire leurs activités collectives, faute de personnel suffisant.
Il ne s’agit donc pas d’un dysfonctionnement ponctuel, mais bien d’un épuisement généralisé. Une charge morale immense pèse sur les épaules de professionnels profondément engagés, mais souvent invisibilisés. Et pourtant, malgré tout, beaucoup continuent. Pour les résidents. Pour la dignité du soin. Ils ne mettent pas en cause les structures elles-mêmes. Ils dénoncent une logique institutionnelle défaillante, un manque de soutien structurel, et une absence d’anticipation à l’échelle nationale.
Sur des forums comme Reddit ou sur le site d’infirmiers.com, les soignants témoignent. Une utilisatrice résume la situation ainsi :
”On était deux aides-soignantes pour 42 résidents. Le matin, les toilettes étaient chronométrées. Je ne me sentais plus humaine.
Mais ces situations ne sont pas le fruit d’une mauvaise volonté des équipes ou des directions. Elles sont la conséquence directe d’un manque de reconnaissance institutionnelle et, parfois, d’une invisibilité médiatique.
2- Les directions en première ligne
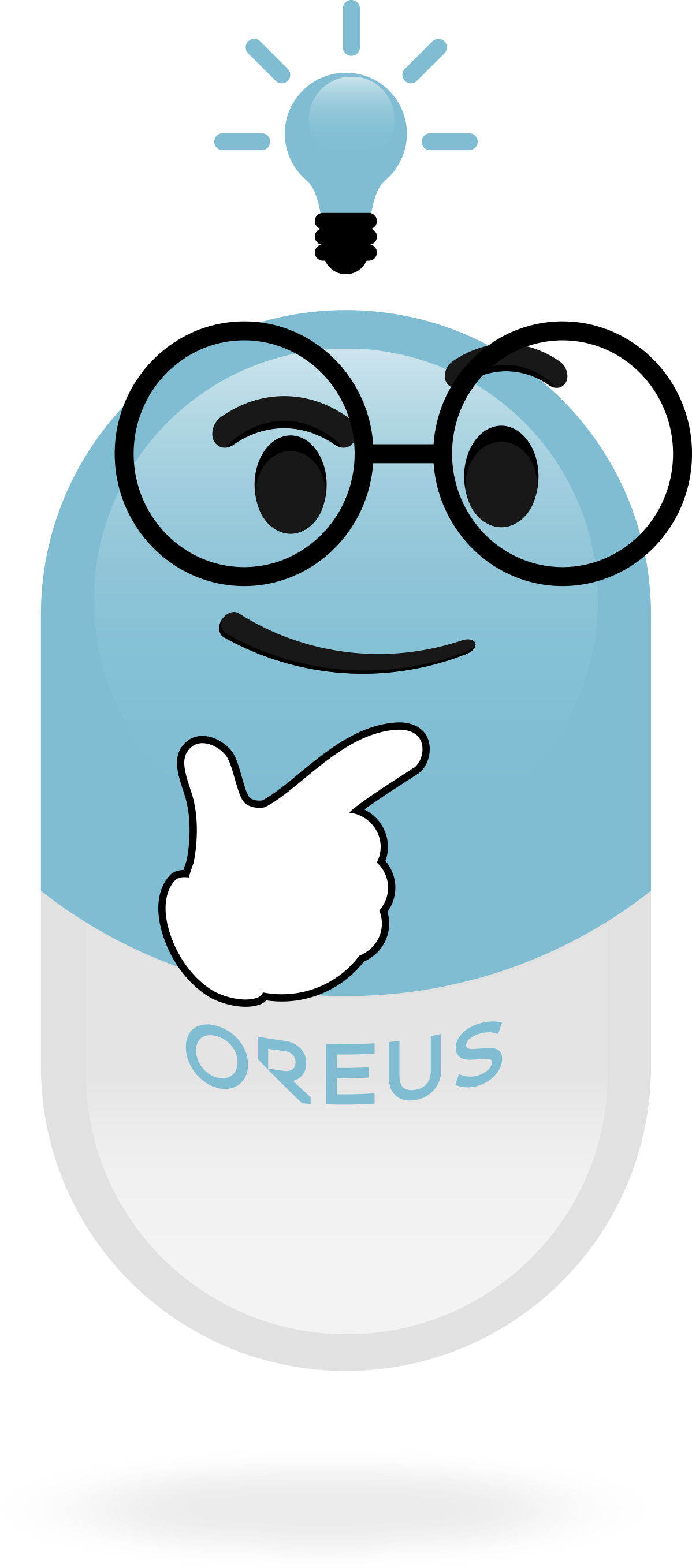
Dans beaucoup d’EHPAD, les directeurs et directrices sont sur tous les fronts. Ils réorganisent les plannings, prennent des astreintes, répondent aux familles, rassurent les équipes. Certains dorment sur place, d’autres repoussent leurs vacances depuis des années. Et pourtant, ils sont souvent les premiers critiqués.
Cette pression ne vient pas uniquement du manque de personnel : elle est aussi structurelle. En effet, les établissements doivent aujourd’hui signer des contrats de performance avec les Agences Régionales de Santé (ARS). Ces contrats imposent un cadre rigoureux : un diagnostic complet de l’établissement, des objectifs chiffrés (taux d’occupation, ratio d’encadrement, heures de soins par résident, retour à l’équilibre financier), un reporting mensuel, et un suivi rapproché par les autorités. En cas de non-respect, les sanctions sont graduées, allant jusqu’à la mise sous administration provisoire.
Autrement dit, les directions doivent à la fois gérer l’urgence humaine sur le terrain et satisfaire à des exigences administratives lourdes. Une double pression constante, renforcée en été, quand les ressources humaines s’amenuisent et que les attentes, elles, restent inchangées.
Pour faire face à cette complexité croissante, l’État a récemment annoncé un triplement du fonds d’urgence dédié aux EHPAD, qui passe de 100 à 300 millions d’euros pour 2025. Une mesure salutaire, mais qui ne dédouane pas les établissements de leurs obligations contractuelles. Le financement supplémentaire intervient dans un contexte de contrôle renforcé, où chaque euro doit être justifié, chaque indicateur respecté.
Par ailleurs, face aux défaillances constatées dans d’autres secteurs comme celui des pharmacies, une question légitime émerge : les EHPAD devront-ils demain assumer directement la prise en charge de la Préparation des Doses à Administrer (PDA) ? Ce transfert de responsabilité, s’il venait à se confirmer, alourdirait encore la charge logistique et financière des établissements, sans garantir les moyens supplémentaires nécessaires.
C’est la réalité de centaines de directeurs d’établissements : ils doivent combler les manques, répondre à l’urgence, tout en rendant des comptes permanents à une administration de plus en plus exigeante. Un exercice d’équilibriste, où l’humain ne devrait jamais être relégué au second plan.
3- Les familles : entre soutien et angoisse
Les familles ont un rôle essentiel dans la vie des résidents, et leurs questionnements sont légitimes. Voir un proche vieillir, se fragiliser, ou simplement changer inquiète. Mais dans cette période où les équipes font souvent face à des situations extrêmes, le dialogue et la compréhension sont plus que jamais indispensables.
Les EHPAD et leurs personnels méritent notre confiance. Jour après jour, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le bien-être et la dignité des résidents, même avec des moyens limités. Leur engagement, leur humanité, leur courage doivent être salués. Nous sommes pleinement solidaires de ces équipes qui, souvent dans l’ombre, tiennent bon pour nos aînés.
4- Quand la chaleur devient un danger
L’épisode caniculaire de 2022 a laissé des traces. Dans un EHPAD de l’Est, une résidente déshydratée est décédée après plusieurs jours sans surveillance médicale. Non pas par négligence, mais parce que personne n’avait pu repasser dans sa chambre depuis midi. Elle était là, silencieuse, invisible.
Ce drame, comme d’autres, n’est pas imputable à une seule personne. Il est le fruit d’un abandon progressif du secteur du grand âge.
Ce que font certains pour tenir
Tous les EHPAD ne sont pas en souffrance constante. Certains innovent, s’organisent, prévoient. En voici quelques exemples inspirants :
- Création d’équipes volantes : un vivier de remplaçants internes, formés et disponibles rapidement.
- Outils de gestion numérique : des logiciels d’alerte et de planification en temps réel.
- Cellules de crise estivales : avec des réunions hebdomadaires pour anticiper les absences.
- Partenariats avec les lycées et les IFSI : intégrer des étudiants en stage pour soulager les équipes.
Ces initiatives montrent que, quand on donne les moyens, les EHPAD sont capables de s’adapter.
5- Cinq leviers pour réduire la casse
Voici cinq pistes concrètes pour amorcer un changement structurel, à la hauteur de l’urgence actuelle :
- Revalorisation salariale ciblée durant les périodes critiques (comme l’été)
Il est essentiel de mieux rémunérer ceux qui tiennent le système à bout de bras pendant les périodes les plus tendues. Une prime estivale renforcée et systématique, cumulable avec les heures supplémentaires, serait une mesure forte. Elle enverrait un signal clair de reconnaissance et inciterait les soignants à ne pas fuir les périodes difficiles. Certaines régions ont déjà expérimenté des incitations locales avec des résultats encourageants. - Plans régionaux de renfort mobilisant des soignants volontaires
À l’instar des réserves sanitaires activées lors du COVID, des plateformes régionales peuvent recenser des professionnels volontaires (retraités actifs, jeunes diplômés, étudiants formés) prêts à intervenir ponctuellement. Ces plans doivent être coordonnés par les ARS, avec une prise en charge logistique (hébergement, frais de déplacement) pour faciliter les missions de courte durée. - Renforcement des formations d’urgence pour les vacataires
Une « université d’été du remplacement » pourrait être imaginée : un module court, accessible en ligne, délivrant une attestation de compétence de base en EHPAD. Il s’agirait d’un prérequis pour les vacataires, validé par une mise en situation supervisée. Cela renforcerait la qualité du soin, tout en sécurisant les équipes déjà en place. - Campagnes nationales de sensibilisation pour restaurer l’image du secteur
Valoriser les métiers du soin, ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Une campagne nationale visible, soutenue par les pouvoirs publics et les médias, pourrait mettre en avant les parcours inspirants de professionnels en EHPAD, les réussites, les liens humains. L’objectif : susciter des vocations, mais aussi retisser un lien de confiance entre société et grand âge. - Allégement administratif des directions en période de crise pour leur permettre de se concentrer sur le terrain
En été, les directeurs sont accaparés par des tâches bureaucratiques lourdes. Un allégement temporaire des obligations réglementaires (report de certaines échéances, simplification des remontées d’indicateurs) permettrait de recentrer les efforts sur l’opérationnel. Une cellule d’appui administrative régionale pourrait être mobilisée sur demande.
Ces leviers ne sont ni utopiques ni hors de portée. Ils existent déjà, parfois à l’état de prototype, dans certains territoires. Il suffit maintenant de les généraliser, de les rendre accessibles, et surtout, de les appliquer avec volonté et cohérence.
L’appel qu’il faut entendre
Il serait injuste et inexact de faire peser la responsabilité de cette crise sur les épaules des EHPAD. Ils sont, bien souvent, les premiers à en subir les conséquences, avec un sens du devoir admirable. Dans un contexte où les moyens ne suivent pas toujours les besoins, ils agissent avec ce qu’ils ont, portés par la volonté de bien faire.
Ce que demandent les équipes, ce n’est pas l’impossible, mais simplement les conditions d’un travail digne et humain. Ce que souhaitent les résidents, ce n’est pas l’exceptionnel, mais une présence attentive, bienveillante et constante.
Alors que la période estivale bat son plein, les équipes en EHPAD sont déjà pleinement mobilisées face aux difficultés. Les tensions sont réelles, les absences nombreuses, les besoins constants. Mais il reste encore possible d’agir, de soutenir, d’accompagner. Il faut des mesures concrètes et durables, mais aussi un regard plus juste sur ces professionnels de l’ombre qui, chaque jour, tiennent bon.







